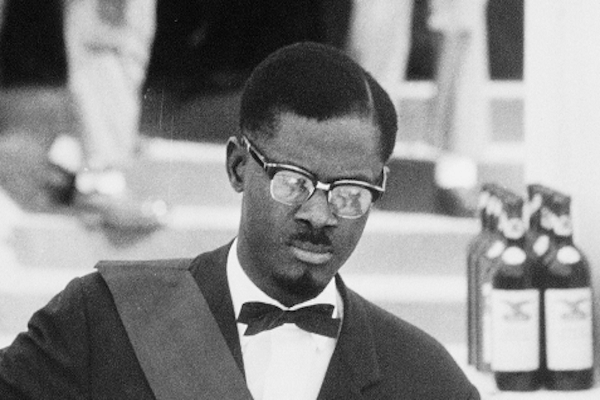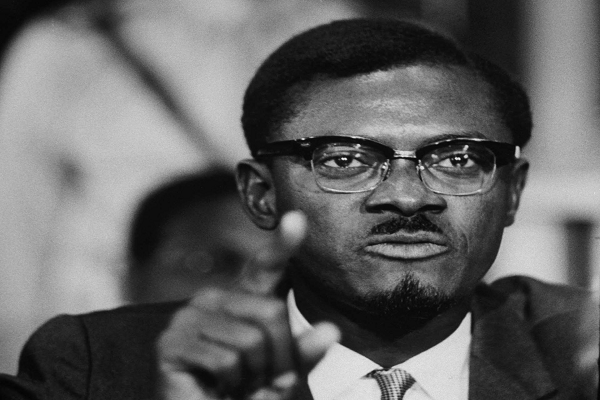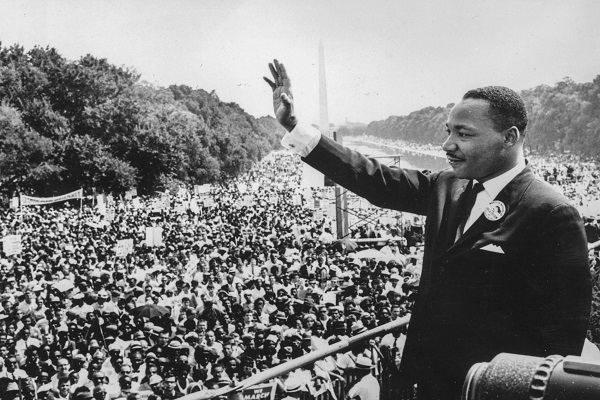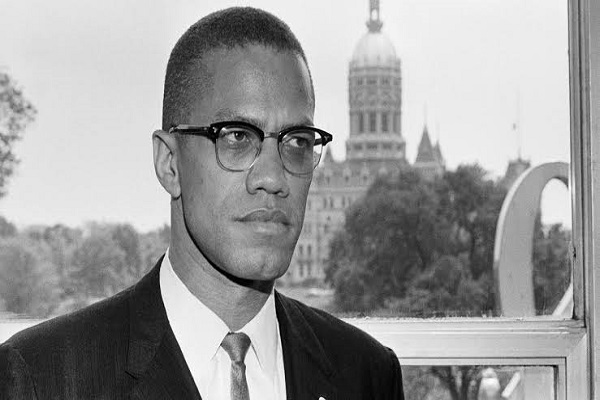Un escalier de plus en plus difficile à monter, des mouvements de doigts qui engendrent des douleurs, le placard de la cuisine qu’on peine à atteindre en levant le bras: autant de signes qui évoquent l’arthrose. Cette affection concernerait de 8 à 15 % de la population et, précise l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 65 % des plus de 65 ans. Contrairement à une idée reçue, elle n’a rien à voir avec une usure des os. Il s’agit d’une maladie à part entière impliquant des processus biochimiques et enzymatiques qui aboutissent à la destruction progressive des structures des articulations: cartilage, os sous-chondral et membrane synoviale.
Malgré l’immense marché que cette pathologie représente pour les laboratoires, l’arsenal thérapeutique n’a guère évolué depuis des années. Pire, certaines molécules largement utilisées pour apaiser les douleurs arthrosiques semblent peu utiles. C’est, en particulier, le cas du paracétamol: la revue Cochrane publiée en 2019 montre qu’il «n’améliore que très peu la douleur et la fonction physique». Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont prescrits en première intention mais ne conviennent pas à tous les patients, les opiacés doivent être consommés de façon exceptionnelle et les injections d’acide hyaluroniques sont déremboursées depuis 2019. Bref: les traitements sont peu nombreux et laissent beaucoup de patients insatisfaits.
Une maladie mieux comprise
«Les besoins de nouvelles molécules sont énormes», résume le Pr Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. La recherche est, heureusement, très active, tant sur la compréhension des mécanismes de l’arthrose que sur la mise au point de nouveaux traitements. «On connaît bien mieux cette maladie aujourd’hui qu’il y a 10 ans, assure le Pr Jérémie Sellam, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine. On sait qu’il existe des arthroses qui diffèrent selon qu’elles trouvent leur origine dans le surpoids, un traumatisme articulaire ou l’âge. Cette distinction entre des maladies différentes laisse entrevoir des prises en charge spécifiques à telle ou telle forme.»
10 millions de Français souffriraient d’arthrose
Société française de rhumatologie (SFR)
Cette meilleure connaissance de la maladie va-t-elle permettre l’émergence de nouvelles thérapeutiques? Certaines pistes suscitant beaucoup d’espoir ont néanmoins débouché sur des impasses. C’est le cas des anti-TNF, une nouvelle classe thérapeutique issue du génie génétique (biothérapie) utilisée avec succès dans plusieurs indications rhumatologiques pour limiter la réaction inflammatoire mais totalement inefficace sur l’arthrose. Idem pour les anti-NGF, des anticorps dirigés contre les facteurs de croissance des cellules transmettant la douleur. L’idée était qu’en les inhibant, le signal douloureux reculerait. Dans les faits, cela fonctionne. Mais, fin octobre 2021, toutes les recherches sur le tanezumab – la molécule faisant l’objet des essais les plus avancés – ont été arrêtées. Une petite quantité de patients développaient, en effet, une arthrose destructrice rapide, autrement dit la destruction de leur articulation s’accélérait subitement. Autre espoir douché, celui placé dans la sprifermine. Dans les études, ce facteur de croissance des cellules du cartilage (les chondrocytes) permet une reconstitution du cartilage laissant entrevoir un traitement curatif. «Mais malgré cet effet structural, les symptômes restent les mêmes et les malades ressentent toujours autant de douleur», regrette le Pr Sellam.